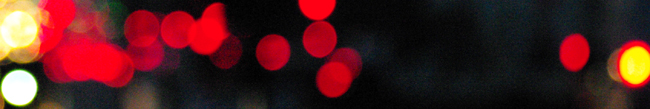L’arrêt rendu le 21 mars 2012 intervient dans une affaire où est opposée à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI la marque antérieure GTI, un signe qui apparaît utilisé de manière descriptive.

28 octobre 2003 : Suzuki Motor Corp dépose la demande de marque communautaire : SWIFT GTi
« Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives ; véhicules terrestres et leurs moteurs et autres pièces, parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12 ; housses pour volants, pour sièges de véhicules et pour véhicules terrestres ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes à pneus de véhicules ; pare-soleil, galeries, porte-bagages, porte-bicyclettes, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules à moteur terrestres »
30 novembre 2004 : Volkswagen AG forme opposition sur la base de différentes marques verbales GTI :
– enregistrement allemand n° 39 406 386, du 27 septembre 1995,
– et l’enregistrement international n° 717592, du 22 juin 1999, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, en Espagne, au Portugal, au Benelux, en France, en Italie, en Autriche et en Suède.
Les deux enregistrements visent « automobiles et leurs pièces ; moteurs automobiles »,
- Une succession d’événements
21 mars 2005 : l’OHMI demande à Volkswagen AG des preuves d’usage de ses deux enregistrements au plus tard le 27 mai 2005
25 mai 2005 : Volkswagen AG présente des documents mais Suzuki en conteste la pertinence
14 septembre 2005 : Suzuki demande à l’OHMI de rectifier la représentation de la marque demandée, si la demande porte sur « SWIFT GTi » avec la lettre « i » finale minuscule, sa publication a été faite sous la forme « SWIFT GTI ».
10 novembre 2005 : l’OHMI indique aux parties :
– qu’une nouvelle publication de la marque va intervenir
– la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à l’expiration du nouveau délai d’opposition commençant à courir à la date de la nouvelle publication
30 janvier 2006 : nouvelle publication. Aucune nouvelle opposition n’a été déposée.
14 mars 2006 : la procédure d’opposition reprend . A cette date le délai d’opposition sur la nouvelle publication n’a pas expiré.
27 mars 2007 : la division d’opposition rejette l’opposition pour insuffisance de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures
14 mai 2007 : recours de Volkswagen contre la décision de la division d’opposition.
9 décembre 2008 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.
Au-delà des débats sur la détermination des marques nationales soumises à l’obligation de l’usage, la chambre de recours a considéré que : « les marques antérieures seraient perçues – au moins intuitivement – comme faisant référence à certaines caractéristiques techniques d’une voiture ou de son moteur, alors que la marque demandée consisterait en une combinaison d’un nom fantaisiste de modèle de véhicule, « swift », suivi d’une référence auxdites caractéristiques techniques »
D’où le recours de Volkswagen devant le Tribunal de l’Union Européenne.
Le tribunal va rejeter le recours
S’agissant du degré d’attention et de connaissances du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que, alors même que l’on ne saurait attendre d’un consommateur moyen un niveau de connaissances et d’attention comparable à celui d’un professionnel du secteur automobile, il convenait néanmoins de présumer que son niveau d’attention à l’égard des produits en cause était supérieur à la moyenne, étant donné que l’achat d’une voiture était l’un des investissements les plus importants que devait normalement faire un consommateur moyen, tandis que l’équipement, les pièces constitutives et les accessoires de voitures étaient des produits relativement onéreux, qui ne faisaient certainement pas partie des achats quotidiens et requéraient une plus grande attention quant à leur compatibilité. De la même manière, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à des consommateurs particulièrement intéressés par les voitures en général ou ponctuellement, par exemple lors du choix d’une voiture. Ceux-ci seraient raisonnablement attentifs et avisés, notamment dans la mesure où ils seraient amenés à investir une somme considérable dans l’achat d’une « voiture ‘GTI’ »
Ainsi, en premier lieu, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de nombreuses preuves tirées de dictionnaires fournies par Suzuki, il ne faisait aucun doute que la combinaison de lettres « gt », et sa variante « gti », étaient des sigles notoirement connus parmi les professionnels du secteur automobile, puisqu’il s’agissait des lettres initiales de « gran turismo », ou de « grand tourisme », et de « gran turismo iniezione », ou de « grand tourisme injection ». Il convient également de relever que, au point 22 de la décision attaquée, sous iv) à xiv), la chambre de recours avait référencé les divers renvois, présentés par Suzuki, aux extraits des dictionnaires portant sur les significations du sigle GTI.
52 Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est encore référée, à cet égard, aux règlements de la Fédération internationale de l’automobile (ci-après la « FIA »), définissant, en outre, un véhicule GT comme une « automobile ouverte ou fermée disposant au plus d’une porte de chaque côté et au moins de deux sièges situés de part et d’autre de la ligne centrale longitudinale de la voiture […] », qui doit « pouvoir être utilisée sur route de façon tout à fait légale et être adaptée à la course sur circuits ou en intérieur ».
53 Selon la chambre de recours, le sigle GTI présente, dès lors, un caractère descriptif.
- Et en particulier en Suède, territoire où la marque antérieure a été retenue
En effet, comme cela ressort des points 51 à 54 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est notamment référée au règlement de la FIA, dont il n’a pas été soutenu qu’elle n’était pas active en Suède, ensuite au site Internet d’un concessionnaire suédois de voitures, Passagen bilweb, cité d’ailleurs à deux reprises, ainsi qu’à l’encyclopédie nationale suédoise Nationalencyklopedin, et enfin à son « expérience générale » portant sur l’utilisation des combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » sur des véhicules, sans limiter territorialement la validité de cette dernière considération.
il convient de relever que, dans la mesure où les éléments présentés par la chambre de recours dans la décision attaquée démontrent, concomitamment, l’enregistrement et l’utilisation d’autres marques détenues par d’autres entreprises et comportant le sigle GTI, l’allégation susvisée de la requérante pourrait, tout au plus, indiquer une éventuelle coexistence entre de telles marques et ses propres marques sur les marchés en cause.