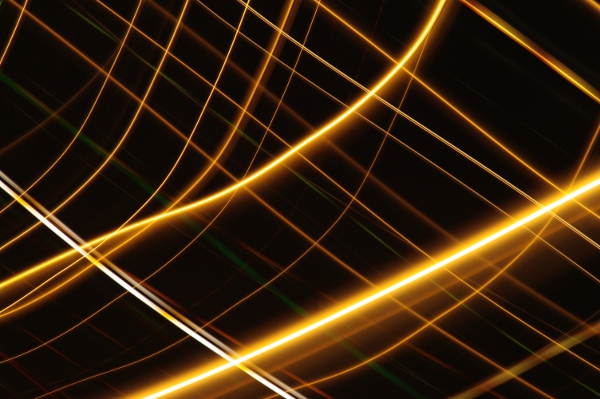L’arrêt du 3 mai 2012 de la Cour de Cassation relance de nombreux débats ……..

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain (les sociétés DKGG), qui commercialisent leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective, ayant fait constater que, par l’intermédiaire des sites d’enchères en ligne des sociétés eBay Inc et eBay AG, des annonceurs offraient à la vente des produits Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo, ont assigné ces deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamnées au paiement de dommages-intérêts et de voir prononcer des mesures d’interdiction ; que les sociétés eBay Inc et eBay AG ( les sociétés eBay) ont soulevé l’incompétence de la juridiction française et la nullité des « constats » dressés par les agents de l’Agence pour la protection des programmes ;
Nous avions déjà eu quelques commentaires en 2008 sur ce jugement
- Les constats sur Internet autre que ceux des huissiers
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés eBay font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces constats et leur rejet des débats, alors, selon le moyen, que les constats établis par les agents de l’Agence pour la protection des programmes relatifs à la constatation de faits qui ne relèvent pas de leur champ de compétence, s’étendant aux infractions liées au droit d’auteur, à ses droits voisins et aux droits des producteurs de données, sont nuls ; qu’un acte nul ne saurait produire aucun effet juridique ; qu’en jugeant néanmoins que les constats établis par les agents de l’APP à la demande de la société Louis Vuitton Malletier, concernant des faits qui seraient constitutifs d’une atteinte au droit des marques, constituaient des éléments de preuve et en se fondant sur eux pour retenir sa compétence puis la responsabilité des sociétés eBay, la cour d’appel a violé l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la preuve de faits juridiques pouvant être rapportée par tous moyens, la cour d’appel a pu retenir que les constatations de l’Agence pour la protection des programmes valaient à titre de simple renseignement ; que le moyen n’est pas fondé ;
- Quel juge est compétent ?
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés eBay font grief à l’arrêt d’avoir dit la société eBay International AG mal fondée en son exception d’incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en matière délictuelle, sont compétentes les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible, si son activité est dirigée vers les internautes de cet Etat ; que c’est au regard de l’activité du site incriminé lui-même, et non d’un autre site, que la notion d’activité «dirigée» doit être appréciée ; qu’en retenant sa compétence pour connaître de l’activité du site anglais ebay.uk aux seuls motifs que le site ebay.fr avait incité les internautes français à le consulter, quand il lui appartenait d’apprécier l’activité du site ebay.uk et non celle d’un autre site pour déterminer si celui-ci visait les internautes français et avait mis en oeuvre des mesures pour les attirer, la cour d’appel a violé l’article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le principe de sécurité juridique et celui de prévisibilité des règles de compétence ;
2°/ qu’en toute hypothèse, en retenant sa compétence pour connaître de l’activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes français à consulter le site voisin ebay.uk, quand aucune des parties n’avait invoqué l’existence d’un procès-verbal duquel il résulterait que le site ebay.fr aurait incité les internautes français à consulter le site anglais et que les sociétés DKGG s’étaient bornées à invoquer, à ce titre, un communiqué de presse d’eBay du 5 mars 2009, visant une campagne commerciale s’étant déroulée en 2009, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en toute hypothèse, en matière délictuelle, la compétence des juridictions de l’Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible doit être appréciée en fonction de l’orientation de ce site à la date à laquelle les faits dénoncés auraient été commis ; qu’en retenant sa compétence pour connaître de l’activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes à consulter le site voisin ebay.uk, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les pièces fournies par les sociétés DKGG n’étaient pas relatives à une campagne commerciale menée en 2009, soit postérieurement à la période litigieuse, qui allait de 2001 à 2006, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d’opérations commerciales pour réaliser des achats et qu’il existe une complémentarité entre ces deux sites ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que le site ebay.uk s’adressait directement aux internautes français, a légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’activité de ce site ;
Attendu, en second lieu, que les sociétés eBay n’ayant pas soutenu que les pièces produites par les sociétés DKGG faisaient référence à des faits se situant en dehors de la période litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
- L‘inévitable débat de la qualité d’hébergeur
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés eBay font grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elles n’avaient pas la seule qualité d’hébergeur et ne pouvaient en conséquence bénéficier, au titre de leur statut de courtier, des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique, d’avoir constaté qu’elles avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG, d’avoir dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective avaient été préjudiciables aux sociétés DKGG et nécessitaient réparation et de les avoir condamnées in solidum au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exercice d’une activité d’hébergement, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, n’est pas exclue par l’exercice d’une activité de courtage, dès lors que le prestataire exerce une activité de stockage des annonces sans contrôler le contenu éditorial de celles-ci ; qu’en jugeant néanmoins que les sociétés eBay ne pouvaient exercer une activité d’hébergement parce qu’elles fournissaient une prestation de courtage en assurant la promotion de la vente des objets mis en vente sur leurs sites, la cour d’appel a violé l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;
2°/ qu’exerce une activité d’hébergement, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, le prestataire qui exerce une activité de stockage, pour mise à disposition du public, de signaux, d’écrits, de messages de toute nature, sans opérer un contrôle de nature à lui confier une connaissance ou une maîtrise des données stockées ; que ce rôle doit être apprécié au regard du contrôle réellement réalisé par le prestataire et non en fonction de celui que ses moyens techniques lui permettraient éventuellement d’exercer ; qu’en jugeant néanmoins que l’appréciation du rôle des sociétés eBay ne devait pas se faire au regard du contrôle que ce prestataire exerçait réellement et en retenant, pour exclure l’exercice d’une activité d’hébergement, qu’elles auraient à leur disposition les moyens de connaître les annonces diffusées par les vendeurs et d’exercer un contrôle éditorial, la cour d’appel a violé l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;
3°/ qu’en toute hypothèse l’existence d’une activité d’hébergement doit être appréciée au regard de chacune des activités déployées par le prestataire ; qu’en jugeant que les sociétés eBay n’exerçaient pas une activité d’hébergement aux motifs que leur activité devait être appréciée globalement, puis en refusant en conséquence de tenir compte de ce qu’il résultait de ses propres constatations que les sociétés eBay auraient des rôles différents selon les options choisies par les vendeurs, de sorte que ce n’était que pour les annonces éditées par ceux d’entre eux qui avaient opté pour des prestations complémentaires telle que l’aide à la rédaction des annonces ou la promotion de leur vente qu’elles pouvaient avoir connaissance des annonces, la cour d’appel a violé l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les sociétés eBay fournissent à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier « d’assistants vendeurs » ; qu’il relève encore que les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l’enchérisseur qui n’a pu remporter une enchère à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 §1 de la Directive 2000/31 ; que le moyen n’est pas fondé ;
- Faut-il distinguer selon le .com et .fr ?
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 46 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir sa compétence à l’égard de la société de droit américain, eBay Inc, l’arrêt relève que la désinence « com » constitue un « TLD » générique qui a vocation à s’adresser à tout public et que les utilisateurs français peuvent consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir du site ebay.fr et y sont même incités ;
Attendu qu’en se déterminant par des motifs impropres à établir que le site ebay.com s’adressait directement au public de France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
- La vente sur Internet et les réseaux de distribution sélective : deux points importants
Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure ;
Attendu que pour dire que les sociétés DKGG justifient de l’existence de réseaux de distribution sélective licites en France et que les sociétés eBay avaient participé indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseaux de distribution sélective mis en place par ces sociétés et engagé leur responsabilité, l’arrêt retient que ces réseaux n’ont pas d’effet sensible sur la concurrence puisque les parts de marché détenues par chacune de ces sociétés sont inférieures à 15 % et que le total des parts de marché détenues est inférieur à 25 % ; qu’il retient encore que ces sociétés n’ont nullement interdit à leurs distributeurs agréés qui disposent de points de vente physiques de recourir au réseau internet pour vendre et promouvoir les parfums ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Ebay soutenaient que les sociétés DKGG ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de l’exemption dès lors que les accords conclus avec les distributeurs de parfums avaient pour objet de fixer les prix de vente, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en ses huitième et neuvième branches :
Vu l’article L. 442-6-I 6° du code de commerce ;
Attendu que pour dire que les sociétés eBay avaient participé à la violation de l’ interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG et avaient engagé leur responsabilité, et pour les condamner à réparation et prononcer des mesures d’interdiction, l’arrêt retient qu’il importe peu que cette violation soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier et relève que ces sociétés ont laissé perdurer, sans prendre de mesures effectives, l’organisation de ventes importantes hors réseaux sur lesquelles elles ont perçu des commissions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
- D’où un arrêt de cassation partielle
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a retenu sa compétence à l’égard de la société eBay Inc, exploitant le site ebay.com, dit que les sociétés eBay avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6-I 6° du code de commerce et condamné les sociétés eBay in solidum à payer diverses sommes aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums aujourd’hui dénommée LVMH Fragrance Brands, Parfums Givenchy aujourd’hui dénommée LVMH Fragrance Brands et à la société Guerlain, l’arrêt rendu le 3 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy ces deux dernières aujourd’hui dénommées LVMH Fragrance Brands et la société Guerlain aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.